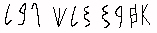La Naissance de l'Alphabet
Deux foyers de civilisation peuvent être retenus comme étant à l'origine de l'invention et de la diffusion de l'écriture: le Proche-Orient et la Chine. Mais si le premier put aboutir à une écriture purement alphabétique, cette dernière ignora cette révolution.
Chronologiquement, les Sumériens et les Elamites du Golfe Persique furent les premiers à connaître l'écriture (3500 av JC). Les suivent de près les proto-indiens de l'Indus et les Egyptiens du Nil (3000 av JC). Les Crétois et les Hittites ont quelques siècles de retard, et les Chinois davantage (2000 av JC). Quant aux Mayas et aux Aztèques, isolés, ils n'inventeront leurs graphies que très tardivement, respectivement au Ier siècle et au XIVe siècle de notre ère.
L'écriture cunéiforme
Le plus ancien système d'écriture qui soit connu est donc l'écriture cunéiforme, inventée par les Sumériens lors de leur établissement dans le delta marécageux de Mésopotamie (Irak actuel) au IVe millénaire avant notre ère. L'origine des Sumériens ainsi que celle de leur langue restent mal connues. Celle-ci n'appartient ni au groupe indo-européen, ni au groupe sémitique.
L'écriture cunéiforme doit son nom à son aspect anguleux (en forme de " coin "). Elle se présentait sous la forme de combinaisons de clous triangulaires qui étaient imprimés, plutôt que tracés, dans des tablettes d'argile avec un roseau taillé en biseau. Les premiers documents écrits (dits de Warqa) montrent une écriture semi-pictographique (le signe-dessin ressemble assez à l'objet qu'il représente). C'est progressivement que cette écriture sumérienne est devenue véritablement cunéiforme (milieu du IIIe millénaire). Ce passage s'explique par la substitution du calame et du poinçon par le seul roseau taillé en biseau qui permettait d'obtenir dans de l'argile, des caractères plus réguliers, aux traits plus accusés, et donc résistant mieux à la cuisson. Ainsi l'oiseau qui était figuré  devint
devint  . On voit comment les matériaux, les instruments et les habitudes des scribes peuvent influer sur la vie des formes graphiques. Par ailleurs, la langue des Sumériens était, en grande partie, monosyllabique et comprenait plusieurs mots homophones (c'est à dire ayant même prononciation mais de sens différents). Cela va rendre possible le procédé du rébus: pour écrire un mot abstrait, on va avoir recours à un pictogramme représentant un mot concret mais se prononçant de la même façon. C'est le contexte de la phrase qui donnera au lecteur la signification réelle de ce pictogramme, devenu phonogramme. C'est ainsi que s'établit la transition entre l'écriture analytique (de mots) et l'écriture phonétique (de sons).
. On voit comment les matériaux, les instruments et les habitudes des scribes peuvent influer sur la vie des formes graphiques. Par ailleurs, la langue des Sumériens était, en grande partie, monosyllabique et comprenait plusieurs mots homophones (c'est à dire ayant même prononciation mais de sens différents). Cela va rendre possible le procédé du rébus: pour écrire un mot abstrait, on va avoir recours à un pictogramme représentant un mot concret mais se prononçant de la même façon. C'est le contexte de la phrase qui donnera au lecteur la signification réelle de ce pictogramme, devenu phonogramme. C'est ainsi que s'établit la transition entre l'écriture analytique (de mots) et l'écriture phonétique (de sons).
Quoiqu'il en soit, cette écriture cunéiforme va connaître un succès posthume pour les Sumériens, puisque, longtemps après leur disparition (au début du IIe millénaire av JC), elle sera encore d'usage. Leurs voisins sémites, les Akkadiens l'avaient récupérée, et les dynasties babyloniennes et assyriennes se chargèrent de la diffuser dans l'ancien monde oriental. C'est ainsi que l'écriture sumérienne cunéiforme, qui servait à transcrire la langue akkadienne, devint au IIe millénaire, l'écriture diplomatique internationale: les pharaons correspondaient avec les rois de Babylone, d'Assyrie et avec les Hittites à l'aide de cette écriture. Il fallut la conquête perse pour que cette écriture perde son hégémonie, se maintenant cependant en Babylonie jusqu'au Ier siècle de notre ère.
D'autres écritures étaient employées au IIe millénaire: les hiéroglyphes bien sûr, mais aussi l'écriture des Hittites, l'écriture proto-indienne ou encore celle des Crétois. Cette dernière était faite de lignes fines, les " linéaires ". qui étaient des syllabogrammes (au nombre de 87).
Mais toutes ces écritures compliquées, faites pour l'usage des princes, réclamaient des hommes de l'art, des scribes. C'est sur la côte phénicienne qu'allait s'élaborer la révolution simplificatrice de l'alphabet, entre les XIVe et Xe siècles av JC, qui permit la démocratisation de l'écriture. " Cette révolution était dans l'air, comme l'écrit Fernand Braudel, car il s'agissait de trouver une écriture facile pour marchands pressés, et capable de transcrire des langues diverses ". Rien d'étonnant si cet effort s'est fait en même temps dans deux villes marchandes exceptionnelles: Ougarit a inventé un alphabet de 31 lettres, utilisant des caractères cunéiformes; Byblos un alphabet linéaire de 22 lettres, qui sera finalement celui des Phéniciens.
Entre l'Egypte et Canaan
Les prémices de cette révolution peuvent être recherchées chez les Egyptiens. En effet, à côté de leurs idéogrammes qui constituaient la base de leur écriture hiéroglyphique, les Egyptiens ont également fait un large emploi des déterminatifs placés après les mots, destinés à préciser le sens des idéogrammes ou à concrétiser celui des mots écrits phonétiquement.
C'est ainsi que vingt-quatre hiéroglyphes, qui correspondent à des mots d'une syllabe, servaient à noter les vingt-quatre consonnes de l'égyptien et cela par le procédé acrophonique (la représentation simplifiée d'un objet sert à noter la première consonne du nom de cet objet). On peut donc affirmer que l'alphabet phénicien n'a pas été une création ex nihilo: sa préhistoire débute avec le Nouvel Empire égyptien (environ 1550). Cette thèse d'après laquelle les lettres phéniciennes ont une parenté avec les hiéroglyphes égyptiens, était apparue avec Champollion, puis elle fut reprise par Emmanuel de Rougé qui en fit une démonstration scientifique. N'oublions pas que, durant le Nouvel Empire, l'Egypte était la puissance dominante, en particulier sur la côte orientale de la Méditerrannée, habitée par les Cananéens, qui occupent aussi l'arrière-pays. Les Phéniciens sont les Cananéens de la côte libanaise, mais le mot " phénicien " n'apparaît alors que dans les textes égyptiens (les " Fenkhu ") et mycéniens, et plus tard dans les poèmes homériques, où le mot " phoinix " désigne à la fois l'habitant et le produit du pays, à savoir la pourpre. Les textes sémitiques ne connaissent eux que les mots " Canaan " et " cananéen " que nous utiliserons dans un premier temps.
Les Cananéens, placés au centre de la zone la plus civilisée du monde d'alors, à la croisée des deux empires égyptien et mésopotamien, étaient des intermédiaires commerciaux universels, et leurs navires sillonnaient la Méditerrannée. Leurs scribes qui écrivaient à leurs clients en hiéroglyphes et en cunéiformes, éprouvèrent plus que leurs voisins le besoin de se dégager de systèmes d'écriture très complexes et de créer un instrument de communication aussi simple que possible. Il leur était plus facile qu'aux Egyptiens ou aux Mésopotamiens de se libérer de traditions vénérables qui, après tout, leur étaient étrangères. Par ailleurs, la langue qu'ils parlaient, le cananéen, est une langue sémitique, et nous verrons que la structure des langues sémitiques est particulièrement favorable à l'analyse des sons que suppose l'alphabet. Certes, l'akkadien des Mésopotamiens est également une langue sémitique, mais le système cunéiforme, à la fois idéographique et syllabique, qu'ils avaient emprunté au IIIe millénaire aux Sumériens, leur en masquait la structure. La langue sumérienne relève en effet d'un tout autre type linguistique.
Au bout du compte, l'alphabet...
Le cananéen est une langue très caractéristique du groupe sémitique: les consonnes y forment à elles seules le cadre inaltérable des racines à partir desquelles on forme les mots de même famille. Les voyelles ne sont que des " motions ", car elles meuvent les consonnes dans la direction de a, de i ou de u (ou) selon la fonction grammaticale du mot: ainsi, la racine MLK composée de trois consonnes, se lit " milk " qui signifie " roi ", ou " mulk " (royauté), ou encore " malak " (régner). C'est au lecteur de vocaliser en fonction du contexte. On conçoit dès lors qu'un Sémite isolera bien plus facilement les sons élémentaires d'un mot qu'un Grec par exemple, pour qui les mots comportent un noyau invariable (radical): dans kara, tête; keras, corne; kêr, mort violente; kêros, cire; koros, jeune homme; kurios, maître, etc... les voyelles sont une partie essentielle du radical. Il est donc indéniable que les Cananéens ont été favorisés par la structure même de leur langue, dans leur recherche d'une écriture simplifiée.
Mais entre leur premier emprunt des hiéroglyphes comme moyen d'écriture et la mise au point de l'alphabet phénicien de 22 signes, il fallut une bonne partie du IIe millénaire durant laquelle il y eut plusieurs tentatives, empruntant souvent leurs signes aux écritures égyptiennes: inscriptions protosinaïtiques (dans la mine de turquoises de Serabit el-Khadem, dans le sud du Sinaï) au nombre de signes assez restreint, inscriptions pseudo-hiéroglyphiques de Byblos que M. Dunand retient comme le maillon le plus assuré de cette préhistoire de l'alphabet. Mais si leur date (XVe siècle?) et leur déchiffrement restent encore très incertains, il n'en est pas de même des alphabets ougaritiques (XIVe-XIIIe siècles) qu'on lit fort bien et qui sont composés, eux, de signes cunéiformes transcrivant des consonnes: le plus employé a trente signes et s'écrit de gauche à droite comme le cunéiforme de Mésopotamie; un autre de 22 à 28 signes, s'écrit de droite à gauche, comme plus tard le phénicien et les écritures qui lui seront apparentées. Ce sont les fouilles de Ras-Shamra, l'antique Ougarit, sur la côte syrienne du Nord, qui ont révélé ces trouvailles extraordinaires que sont les nombreuses tablettes d'argile à écriture alphabétique dont la langue est le cananéen d'Ougarit (et non pas l'akkadien, qui était, rappelons-le, la langue diplomatique internationale). On a même trouvé de véritables abécédaires d'écolier, intacts. Les signes, d'aspect cunéiforme mais simplifié, ont tous une valeur consonantique. Ougarit, située non loin de Lattaquié, était alors un grand port cosmopolite. Cette ville disparut lors de l'invasion des " Peuples de la mer " qui a ravagé toute la côte du Levant à la fin du XIIIe siècle av JC. Mais le principe de son écriture survécut dans différentes localités de Palestine où des textes au déchiffrement ardu, montrent qu'il s'agissait d'expériences locales sans suite.
Puis, vers 1100 avant JC, c'est le triomphe d'un alphabet nouveau de 22 lettres (consonnes) entièrement linéaire (non cunéiforme) qu'on appelle phénicien. Il ne peut être inventé que dans une ville importante: c'est à Byblos (l'actuel Gebayl, au nord de Beyrouth) qu'il nous faudra revenir pour trouver la série de textes contenant l'ancêtre de notre alphabet d'aujourd'hui. Cette ville semble avoir moins souffert que les autres de l'invasion des " Peuples de la mer ", et c'est la seule où l'on ait trouvé des textes anciens écrits en alphabet phénicien. Le plus connu de ces textes byblites est l'épitaphe du sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos. Cet alphabet est donc l'aboutissement final de l'écriture hiéroglyphique des Egyptiens dont les relations traditionnelles avec Byblos sont attestées. Il est clair que dans leur collection de lettres, les scribes phéniciens s'inspirèrent des signes hiéroglyphiques dont ils simplifièrent le dessin, en les adaptant à leur langue, et surtout en s'affranchissant de la formule idéographique qui restait intangible aux yeux des scribes égyptiens.
Ainsi, pour transcrire le son M, ils eurent recours à une ligne brisée semblable au hiéroglyphe égyptien désignant l'eau, car " eau " en langue sémitique se disait mêm (le mot égyptien est d'ailleurs de même racine). De même, ils empruntèrent la tête de boeuf au hiéroglyphe égyptien pour " boeuf ". Mais cette fois, le nom égyptien est différent du mot sémitique qui est 'aleph et qui donnera son nom à la consonne "'", son faible qu'on émet en ouvrant brusquement la glotte. En somme, pour transcrire un son, on utilise la représentation d'un objet dont le nom commence par ce son: 'aleph (boeuf), bêth (maison), guimel (chameau), daleth (porte), yôd (bras), kaph (paume), mêm (eau), 'ain (oeil), rêsh (tête), shin (dent)...
Mais cette thèse est contestée et on pense plutôt que, une fois réalisé l'effort essentiel d'invention alphabétique, les Phéniciens ont créé arbitrairement la plupart de leurs signes: les dénominations des lettres ne seraient que des désignations après coup, se rattachant plus ou moins vaguement aux formes inventées.
En ce qui concerne la direction de l'écriture, elle a longtemps varié au cours du IIe millénaire: les inscriptions sont tracées indifféremment de droite à gauche, de gauche à droite, ou de haut en bas. On trouve même des cas d'écriture en boustrophédon, c'est à dire où l'on inverse, de ligne à ligne, l'orientation des caractères, à la manière d'un boeuf traçant des sillons dans un champ (le "E" devient  à la ligne suivante). C'est avec les inscriptions royales de Byblos (Xe siècle) que l'écriture devient définitivement sénestrogyre (de droite à gauche), comme le sont encore aujourd'hui l'arabe et l'hébreu.
à la ligne suivante). C'est avec les inscriptions royales de Byblos (Xe siècle) que l'écriture devient définitivement sénestrogyre (de droite à gauche), comme le sont encore aujourd'hui l'arabe et l'hébreu.
Pour illustrer l'écriture alphabétique phénicienne, examinons l'inscription suivante: (lire de droite à gauche)
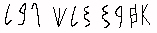
L B G K L M M R H '
Elle se lit: " 'AHIRAM MILK GIBL ", ce qui signifie " Ahiram roi de Gibl (Byblos) ".
Nous verrons plus loin par quelles transformations les lettres phéniciennes nous ont donné nos lettres latines, ainsi que les autres alphabets.
Cadmus
 devint
devint  . On voit comment les matériaux, les instruments et les habitudes des scribes peuvent influer sur la vie des formes graphiques. Par ailleurs, la langue des Sumériens était, en grande partie, monosyllabique et comprenait plusieurs mots homophones (c'est à dire ayant même prononciation mais de sens différents). Cela va rendre possible le procédé du rébus: pour écrire un mot abstrait, on va avoir recours à un pictogramme représentant un mot concret mais se prononçant de la même façon. C'est le contexte de la phrase qui donnera au lecteur la signification réelle de ce pictogramme, devenu phonogramme. C'est ainsi que s'établit la transition entre l'écriture analytique (de mots) et l'écriture phonétique (de sons).
. On voit comment les matériaux, les instruments et les habitudes des scribes peuvent influer sur la vie des formes graphiques. Par ailleurs, la langue des Sumériens était, en grande partie, monosyllabique et comprenait plusieurs mots homophones (c'est à dire ayant même prononciation mais de sens différents). Cela va rendre possible le procédé du rébus: pour écrire un mot abstrait, on va avoir recours à un pictogramme représentant un mot concret mais se prononçant de la même façon. C'est le contexte de la phrase qui donnera au lecteur la signification réelle de ce pictogramme, devenu phonogramme. C'est ainsi que s'établit la transition entre l'écriture analytique (de mots) et l'écriture phonétique (de sons).  à la ligne suivante). C'est avec les inscriptions royales de Byblos (Xe siècle) que l'écriture devient définitivement sénestrogyre (de droite à gauche), comme le sont encore aujourd'hui l'arabe et l'hébreu.
à la ligne suivante). C'est avec les inscriptions royales de Byblos (Xe siècle) que l'écriture devient définitivement sénestrogyre (de droite à gauche), comme le sont encore aujourd'hui l'arabe et l'hébreu.